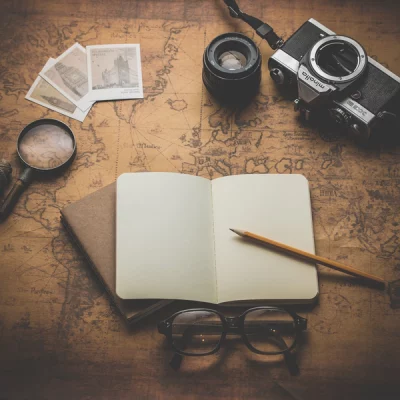Ile-de-France
Plaisirs de la table et beautés naturelles : notre région a tant à offrir !
Nos spécialités culinaires régionales
La soupe à l’oignon se prépare en faisant brunir dans une matière grasse des oignons émincés. On y ajoute de l’eau, on laisse mijoter un peu avant de mettre la soupe dans des bols et de l’agrémenter de croûtons et fromage râpé et la passer au four durant quelques minutes.
Les soupes à l’oignon sont populaires au moins depuis l’époque romaine. Elles furent à travers l’Histoire souvent considérées comme une nourriture pour gens modestes, en raison de l’abondance des oignons et de la facilité à les cultiver. La version moderne de cette soupe est venue de France au XVIIe siècle, faite de pain sec ou croûtons, bouillon de bœuf et oignons caramélisés.
Ce mets est composé de viande de bœuf restante d’un pot-au-feu, coupée en dés ou en morceaux, revenue à la poêle avec des petits oignons et une botte de carottes.
Le miroton, mets à base de viande rouge, s’accorde parfaitement avec des vins de la même couleur. On peut choisir soit un vin rouge dans les appellations du sud-ouest comme gaillac, irouléguy, buzet, fronton ou bergerac, sinon celles de l’axe Saône-Rhône telles que saint-amour, beaujolais-villages, coteaux bourguignons ou châtillon-en-diois.
Le brie de Meaux est un fromage au lait cru dont l’appellation d’origine est préservée commercialement via une AOC depuis 1980. Son aire de production s’étend des plaines briardes jusqu’à la Meuse. Son appellation vient de la région de la Brie et de la commune de Meaux en France.
C’est un fromage à base de lait de vache, cru à pâte molle à croûte fleurie, d’un poids moyen de 2,8 kg pour un diamètre de 36 à 37 cm. Sa croûte est fine, d’un blanc duveteux et parsemée de taches rouges. Sa pâte est couleur jaune paille, onctueuse et souple mais non coulante.
Sa pâte jaune paille faite à cœur révèle un goût de noisette et une légère odeur de fermentation. Plus il est affiné, plus il est corsé. De nombreux vins (rouges ou blancs) peuvent accompagner le brie de Meaux : bourgogne, côtes du Rhône, saint-émilion, pomerol, pinot-noir d’Alsace, voire champagne… Certains conseillent plutôt le cidre, de préférence de la même région.
Il entre également dans la confection de nombreuses spécialités culinaires de la région de la Brie : les galettes briardes, les bouchées à la reine au brie de Meaux…
Le macaron est une mignardise française à l’amande, granuleux et moelleux, à la forme arrondie, d’environ 3 à 5 cm de diamètre, dérivé de la meringue.
Il est fabriqué à partir d’amandes concassées, de sucre glace, de sucre et de blancs d’œufs, la quantité d’amande devant être égale à la quantité de sucre glace (ce qu’on appelle le tant pour tant). La pâte ainsi préparée est déposée sur une plaque de four et cuite. Ceci lui donne sa forme particulière d’une pâte figée et dorée à la cuisson. Le macaron est ensuite fourré avec une ganache dont les goûts peuvent différer.
Le macaron ne doit pas être confondu avec les confiseries à base de pâte d’amande appelées massepain, ni avec les rochers au coco à base de chair de noix de coco râpée.
En 1955, Dalloyau s’inspire des Parisiens qui passent leurs fins de semaine à la campagne et crée le « week-end », le tout premier gâteau de voyage, qui s’emballe, se transporte et se conserve facilement.
L’opéra, gâteau créé en 1955 par Cyriaque Gavillon, est connu aujourd’hui à travers le monde. En forme de parallélipipède, il est composé de trois feuilles de biscuit Joconde imbibé d’un sirop de café et garni de crème au beurre au café et de ganache au chocolat. Le dessus est recouvert d’un glaçage au chocolat profondément noir. Cyriaque Gavillon voulait créer une nouvelle forme d’entremets avec des tranches apparentes, pour lequel une seule bouchée suffisait à donner le goût du gâteau entier. C’est son épouse Andrée Gavillon qui le baptisa opéra en hommage aux danseuses et aux « petits rats » de l’Opéra, qui faisaient des entrechats dans la boutique.
Le paris-brest est une pâtisserie traditionnelle d’origine française, en forme toroïdale évoquant une roue de vélo, pour rendre hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. Elle est composée d’une pâte à choux croquante fourrée d’une crème mousseline pralinée, parsemée d’amandes effilées.
Ce gâteau en forme de roue de vélo rend hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. Sa création est attribuée à différents pâtissiers résidant sur le passage de la course, parmi lesquels : Louis Durand, de Maisons-Laffitte, qui l’aurait conçu en 1909, ; Monsieur Bauget, également de Maisons-Laffitte, mais en 1891 ; d’autres sources citent simplement un pâtissier de la banlieue parisienne, qui l’aurait créé en 1891 ; enfin, un pâtissier de Chartres du nom de Gerbet.
La réalisation de ce dessert utilise une pâte à choux cuite avec des amandes effilées parsemées en surface, dans laquelle on introduit, après cuisson de la pâte, une torsade de crème pâtissière ou pralinée. Les variantes usuellement rencontrées portent sur la nature de la crème utilisée. Chaque pâtissier utilise aujourd’hui des crèmes plus différentes les unes que les autres. La crème la plus classiquement utilisée est la crème mousseline (crème pâtissière que l’on émulsionne par l’ajout de beurre pommade ou de crème au beurre). D’autres utilisent une crème au beurre pour des raisons de conservation, éventuellement en y ajoutant de la mousse de lait pour l’alléger, ou encore une crème chiboust. Les ouvrages de cuisine citent également une crème intitulée tout simplement crème à paris-brest, et qui est généralement une crème mousseline pralinée parfumée au rhum.
Nos lieux historiques incontournables
La tour Eiffelest une tour de fer puddlé de 330 m de hauteur (avec antennes) située à Paris, à l’extrémité nord-ouest du parc du Champ-de-Mars en bordure de la Seine dans le 7e arrondissement. Son adresse officielle est , avenue Anatole-France.
Construite en deux ans par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l’Exposition universelle de Paris de 1889, célébrant le centenaire de la Révolution française, et initialement nommée « tour de 300 mètres », elle est devenue le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan : il s’agit du quatrième site culturel français payant le plus visité en 2016, avec 5,9 millions de visiteurs. Depuis son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs.
D’une hauteur de 312 mètres à l’origine, la tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant quarante ans. Le second niveau du troisième étage, appelé parfois quatrième étage, situé à 279,11 mètres, est la plus haute plateforme d’observation accessible au public de l’Union européenne et la deuxième plus haute d’Europe, derrière la tour Ostankino à Moscou culminant à 337 mètres. La hauteur de la tour a été plusieurs fois augmentée par l’installation d’un drapeau puis de nombreuses antennes, notamment en 1957 (320,75 m), 1991, 1994, 2000 et 2022. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert aujourd’hui d’émetteur de programmes radiophoniques et télévisés.
La cathédrale Notre-Dame de Paris, communément appelée Notre-Dame, est l’un des monuments les plus emblématiques de Paris et de la France. Elle est située sur l’île de la Cité et est un lieu de culte catholique, siège de l’archidiocèse de Paris, dédié à la Vierge Marie.
Commencée sous l’impulsion de l’évêque Maurice de Sully, sa construction s’étend sur environ deux siècles, de 1163 au milieu du XIVe siècle. Après la Révolution française, la cathédrale bénéficie entre 1845 et 1867 d’une importante restauration, parfois controversée, sous la direction de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui y incorpore des éléments et des motifs inédits, dont une nouvelle flèche. Pour ces raisons, le style n’est pas d’une uniformité totale : la cathédrale possède certains des caractères du gothique primitif et du gothique rayonnant. Les deux rosaces qui ornent chacun des bras du transept sont parmi les plus grandes d’Europe.
La cathédrale est liée à de nombreux épisodes de l’histoire de France. Église paroissiale royale au Moyen Âge, elle accueille l’arrivée de la Sainte Couronne en 1239, puis le sacre de Napoléon Ier en 1804, le baptême du dernier des Bourbons de France en 1821, ainsi que les funérailles de plusieurs présidents de la République française (Adolphe Thiers, Sadi Carnot, Paul Doumer, Georges Pompidou, François Mitterrand). C’est aussi sous ses voûtes qu’est chanté un Magnificat lors de la libération de Paris, en 1944. Le 850e anniversaire de sa construction est célébré en 2013.
La cathédrale inspire de nombreuses œuvres artistiques, notamment le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris paru en 1831 et qui influence en retour en partie son histoire. Au début du XXIe siècle, Notre-Dame est visitée chaque année par quelque 13 à 14 millions de personnes. L’édifice, aussi basilique mineure, est ainsi le monument le plus visité en Europe et l’un des plus visités au monde jusqu’en 2019, et de ceux qui ont suscité une réflexion sur une régulation des flux touristiques.
Le violent incendie du 15 avril 2019 détruit la flèche et la totalité de la toiture couvrant la nef, le chœur et le transept. Il s’agit du plus important sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction. Dès lors, Notre-Dame a été fermée au public. La reconstruction à l’identique des parties détruites ou gravement endommagées est décidée en 2020. La cérémonie officielle de réouverture de Notre-Dame a lieu le 7 décembre et l’ouverture au public le 8 décembre 2024.
L’arc de triomphe de l’Étoile, souvent appelé simplement l’Arc de Triomphe, est un monument de type tétrapyle situé à Paris, en un point haut à la jonction des territoires des 8e, 16e et 17e arrondissements, notamment au sommet de l’avenue des Champs-Élysées et de l’avenue de la Grande-Armée, lesquelles constituent un grand axe est-ouest parisien partant de la pyramide du Louvre, passant par l’obélisque de La Concorde, l’Arc de Triomphe lui-même et se terminant au loin par l’arche de la Défense. Sa construction, décidée par l’empereur Napoléon Ier, débute en 1806 et s’achève en 1836 sous le règne de Louis-Philippe.
Napoléon Ier, au lendemain de la bataille d’Austerlitz, déclare aux soldats français : « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe. » L’Empereur s’est référé aux arcs de triomphe érigés sous l’Empire romain afin de commémorer un général vainqueur défilant à la tête de ses troupes.
L’Arc de Triomphe s’élève au centre de la place Charles-de-Gaulle (anciennement place de l’Étoile) dans les 8e, 16e, et 17e arrondissements de Paris1. Il est situé dans l’axe et à l’extrémité ouest de l’avenue des Champs-Élysées, à 2,2 kilomètres de la place de la Concorde. C’est un tétrapyle haut de 49,54 m, large de 44,82 m et profond de 22,21 m, géré par le Centre des monuments nationaux.
La basilique Saint-Denis de Saint-Denis est une église de style gothique située au centre de la ville de Saint-Denis.
Fondée à l’origine en tant qu’abbatiale, elle a le statut de cathédrale du diocèse de Saint-Denis depuis 1966.
À ses origines, l’ancienne abbaye royale de Saint-Denis est associée à l’histoire des Francs. L’église abbatiale a été dénommée « basilique » dès l’époque mérovingienne (comme beaucoup d’autres églises). Elle s’élève sur l’emplacement d’un cimetière gallo-romain, lieu de sépulture de saint Denis de Paris martyrisé vers 250. Le transept de l’église abbatiale, d’une ampleur exceptionnelle, était destiné à accueillir les tombeaux royaux. Elle est ainsi la nécropole royale des rois de France depuis les Robertiens et Capétiens directs, même si plusieurs rois mérovingiens puis carolingiens avaient choisi d’y reposer avant eux.
La basilique Saint-Denis est classée au titre des monuments historiques par liste de 1862. Le jardin Pierre-de-Montreuil qui l’entoure est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 19 août 1926.
La basilique est desservie à 400 mètres par la ligne 1 du tramway et par la ligne 13 du métro à la station Basilique de Saint-Denis.
Le château de Versailles est un château et un monument historique français situé à Versailles, dans les Yvelines. Il fut la résidence principale des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le roi, la cour et le gouvernement y résidèrent de façon permanente du 6 mai 1682 au 6 octobre 1789, à l’exception des années de la Régence de 1715 à 1723. Voulu par Louis XIV afin de glorifier la monarchie française, le château est le plus important monument de son règne et l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture classique. Il exerça une grande influence en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles dans le domaine de l’architecture et des arts décoratifs.
Le château est constitué d’un ensemble complexe de cours et de corps de bâtiments préservant une harmonie architecturale. Il s’étend sur 63 154 m2, répartis en 2 300 pièces dont 1 000 sont affectées au musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
Le parc du château de Versailles s’étend sur 815 ha, contre plus de 8 000 ha avant la Révolution française , dont 93 ha de jardins. Il comprend de nombreux éléments, dont le Petit et le Grand Trianon (qui fut la résidence de Napoléon Ier, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe Ier, et Napoléon III), le hameau de la Reine, le Grand et le Petit Canal, une ménagerie (aujourd’hui détruite), une orangerie et la pièce d’eau des Suisses. Parmi les plus fréquentés d’Europe, le site est au cœur des réflexions sur la gestion du surtourisme.
Le château de Fontainebleau est un château royal de styles principalement Renaissance et classique, près du centre-ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne), à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris, en France. Les premières traces d’un château à Fontainebleau remontent au XIIe siècle. Les derniers travaux sont effectués au XIXe siècle.
Haut lieu de l’histoire de France, le château de Fontainebleau est l’une des demeures des souverains français depuis François Ier, qui en fait sa demeure favorite, jusqu’à Napoléon III. Plusieurs rois laissent leur empreinte dans la construction et l’histoire du château, qui est ainsi un témoin des différentes phases de l’histoire de France depuis le Moyen Âge. Entouré d’un vaste parc et voisin de la forêt de Fontainebleau, le château se compose d’éléments de styles médiévaux, Renaissance, et classiques. Il témoigne de la rencontre entre l’art italien et la tradition française exprimée tant dans son architecture que dans ses décors intérieurs. Cette spécificité s’explique par la volonté de François Ier de créer à Fontainebleau une « nouvelle Rome », dans laquelle les artistes italiens viennent exprimer leur talent et influencer l’art français.
C’est ainsi que naît l’École de Fontainebleau, qui représente la période la plus riche de l’art renaissant en France, et inspire la peinture française jusqu’au milieu du XVIIe siècle, voire au-delà. Napoléon Ier surnomme ainsi le château la « maison des siècles », évoquant par là les souvenirs historiques dont les lieux sont le témoignage.
Le château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862, classement complété par plusieurs arrêtés pris en 1913, 1930, 2008 et 2009. Par ailleurs, depuis 1981, le château fait partie avec son parc du patrimoine mondial de l’UNESCO. Riche d’un cadre architectural de premier ordre, le château de Fontainebleau possède également une des plus importantes collections de mobilier ancien de France, et conserve une exceptionnelle collection de peintures, de sculptures, et d’objets d’art, allant du VIe au XIXe siècle.